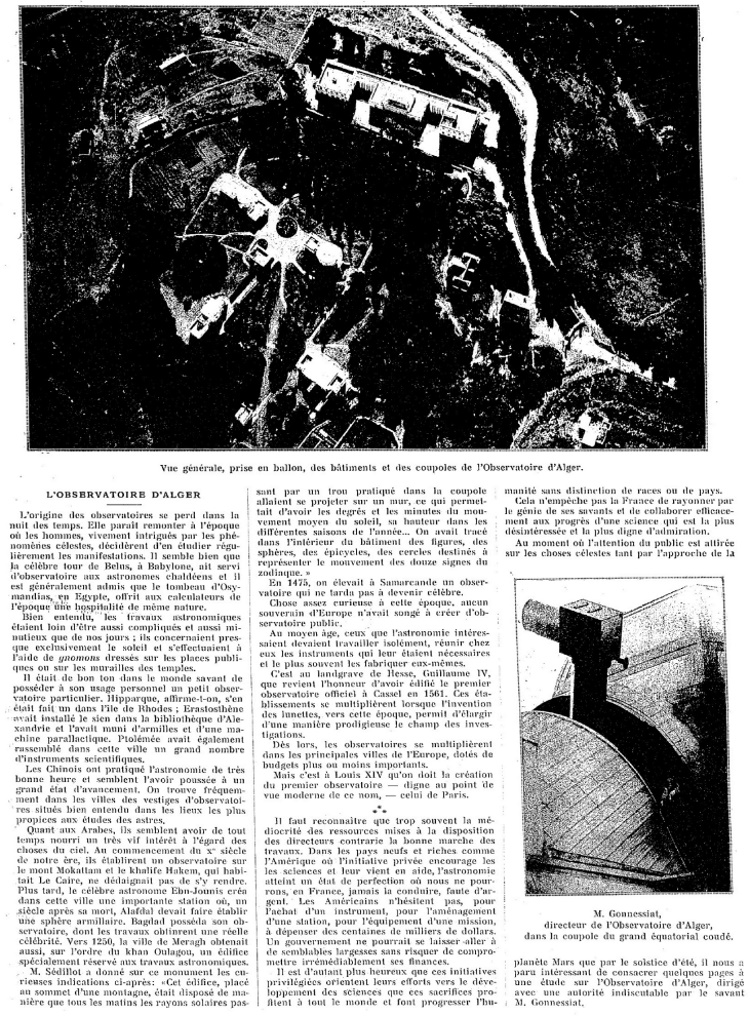
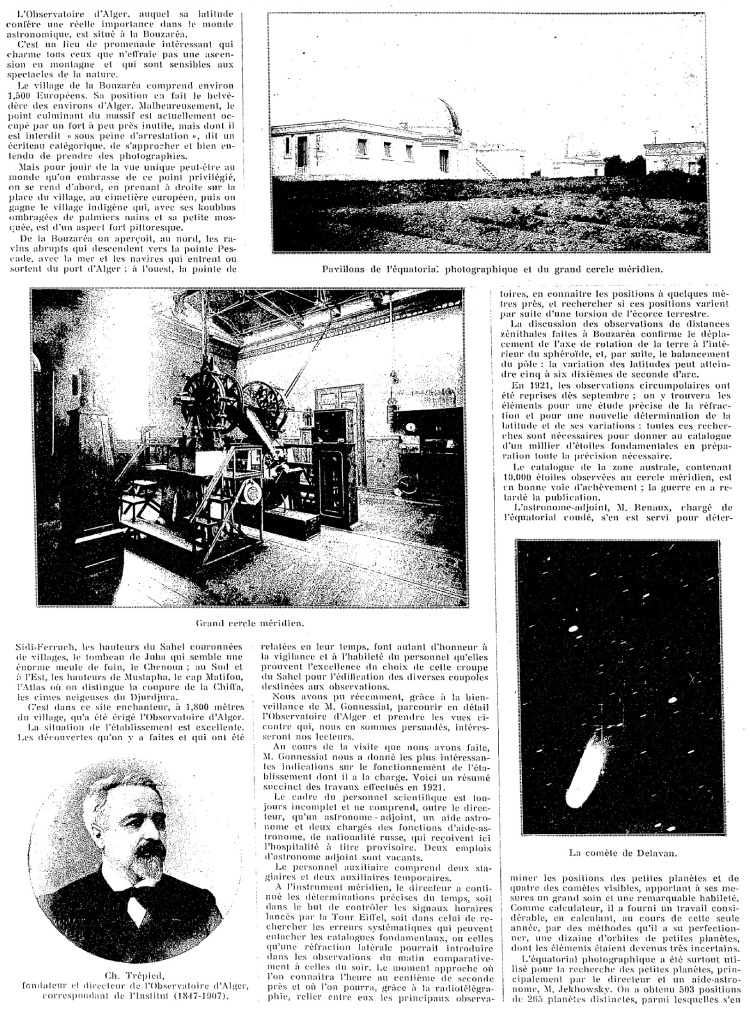
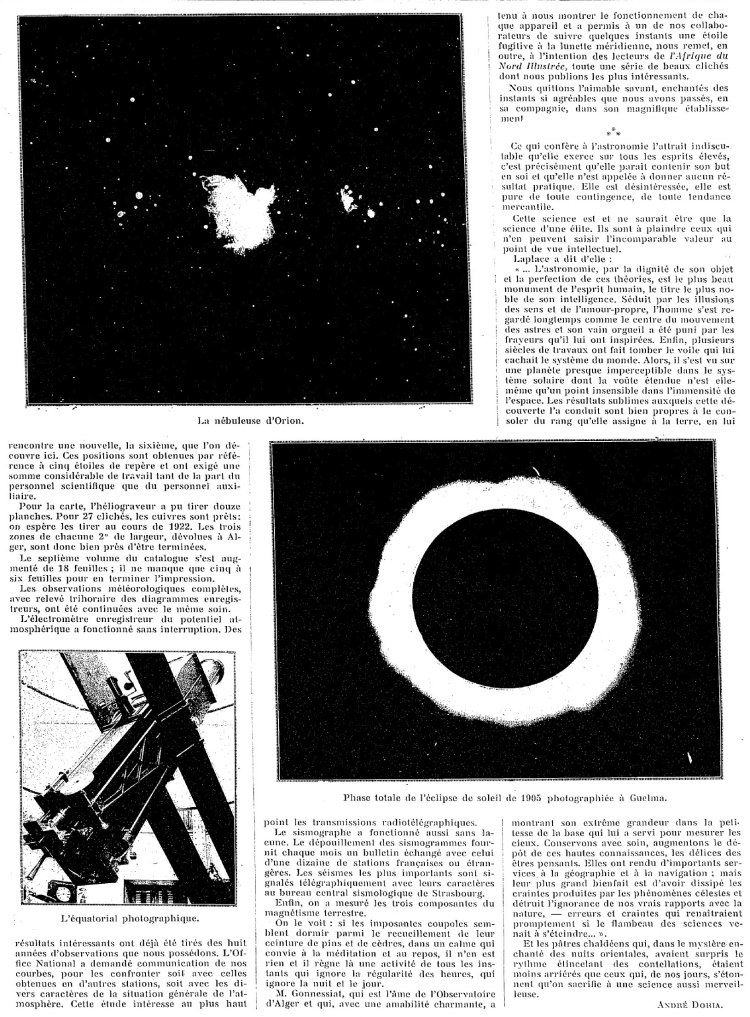
L’OBSERVATOIRE D'ALGER
L'origine
des observatoires se perd dans la nuit des temps. Elle paraît remonter
à l'époque ; où les hommes, vivement intrigués
par les phénomènes célestes, décidèrent
d'en étudier régulièrement les manifestations. Il
semble bien que la célèbre tour de Belus, à Babylone,
ait servi d'observatoire aux astronomes chaldéens et il est généralement
admis que le tombeau d'Osymandias, en Égypte, offrit aux calculateurs
de l'époque une hospitalité de même nature.
Bien entendu, les travaux astronomiques étaient loin d'être
aussi compliqués et aussi minutieux que de nos jours ; ils concernaient
presque exclusivement le soleil et s'effectuaient à l'aide de gnomons
dressés sur les places publiques ou sur les murailles des temples.
Il était de bon ton dans le monde savant de posséder à
son usage personnel un petit observatoire particulier. Hipparque, affirme-t-on,
s'en était fait un dans l'île de Rhodes ; Erastosthène
avait installé le sien dans la bibliothèque d'Alexandrie
et l'avait muni d'armilles et d'une machine parallactique. Ptolémée
avait également rassemblé dans cette ville un grand nombre
d'instruments scientifiques.
Les Chinois ont pratiqué l'astronomie de très bonne heure
et semblent l'avoir poussée à un grand état d'avancement.
On trouve fréquemment dans les villes des vestiges d'observatoires
situés bien entendu dans les lieux les plus propices aux études
des astres.
Quant aux Arabes, ils semblent avoir de tout temps nourri un très
vif intérêt à l'égard des choses du ciel. Au
commencement du Xème siècle de notre ère, ils établirent
un observatoire sur le mont Mokattam et le khalife Hakem, qui habitait
Le Caire, ne dédaignait pas de s'y rendre. Plus tard, le célèbre
astronome Ebn-Jounis créa dans cette ville une importante station
où, un siècle après sa mort, Alafdal devait faire
établir une sphère armillaire. Bagdad posséda son
observatoire, dont les travaux obtinrent une réelle célébrité.
Vers 1250, la ville de Meragh obtenait aussi, sur l'ordre du khan Oulagou,
un édifice spécialement réservé aux travaux
astronomiques. M. Sédillot a donné sur ce monument les curieuses
indications ci-après: «Cet édifice, placé au
sommet d'une montagne, était disposé de manière que
tous les matins les rayons solaires passant passant un trou pratiqué
dans la coupole allaient se projeter sur un mur, ce qui permettait d'avoir
les degrés et les minutes du mouvement moyen du soleil, sa hauteur
dans les différentes saisons de l'année... On avait tracé
dans l'intérieur du bâtiment des ligures, des sphères,
des épicycles, des cercles destinés à représenter
le mouvement des douze signes du zodiaque.»
En 1475, on élevait à Samarcande un observatoire qui ne
tarda pas à devenir célèbre.
Chose assez curieuse à cette époque, aucun souverain d'Europe
n'avait songé à créer d'observatoire public.
Au moyen âge, ceux que l'astronomie intéressaient devaient
travailler isolément, réunir chez eux les instruments qui
leur étaient nécessaires et le plus souvent les fabriquer
eux-mêmes.
C'est au landgrave de Hesse, Guillaume IV, que revient l'honneur d'avoir
édifié le premier observatoire officiel à Cassel
en 1551. Ces établissements se multiplièrent lorsque l'invention
des lunettes, vers cette époque, permit d'élargir d'une
manière prodigieuse le champ des investigations.
Dès lors, les observatoires se multiplièrent dans les principales
villes de l'Europe, dotés de budgets plus ou moins importants.
Mais c'est à Louis XIV qu'on doit la création du premier
observatoire - digne au point de vue moderne de ce nom, - celui de Paris.
Il faut reconnaître que trop souvent la médiocrité
des ressources mises à la disposition des directeurs contrarie
la bonne marche des travaux. Dans les pays neufs et riches comme l'Amérique
où l'initiative privée encourage les sciences et leur vient
en aide, l'astronomie atteint un état de perfection où nous
ne pourrons, en France, jamais la conduire, faute d'argent. Les Américains
n'hésitent pas, pour l'achat d'un instrument, pour l'aménagement
d'une station, pour l'équipement d'une mission, à dépenser
des centaines de milliers de dollars. Un gouvernement ne pourrait se laisser
aller à de semblables largesses sans risquer de compromettre irrémédiablement
ses finances.
Il est d'autant plus heureux que ces initiatives privilégiées
orientent leurs efforts vers le développement des sciences que
ces sacrifices profitent à tout le monde et font progresser l'humanité
sans distinction de races ou de pays.
Cela n'empêche pas la France de rayonner par le génie de
ses savants et de collaborer efficacement aux progrès d'une science
qui est la plus désintéressée et la plus digne d'admiration.
Au moment où l'attention du public est attirée sur les choses
célestes tant par l'approche de la planète Mars que par
le solstice d'été, il nous a paru intéressant de
consacrer quelques pages à une étude sur l'Observatoire
d'Alger, dirigé avec une autorité indiscutable par le savant
M. Gonnessiat.
L'Observatoire d'Alger, auquel sa latitude confère une réelle
importance dans le monde astronomique, est situé à la Bouzaréa.
C'est un lieu de promenade intéressant qui charme tous ceux que
n'effraie pas une ascension en montagne et qui sont sensibles aux spectacles
de la nature.
Le village de la Bouzaréa comprend environ 1.500 Européens.
Sa position en fait le belvédère des environs d'Alger. Malheureusement,
le point culminant du massif est actuellement occupé par un fort
à peu près inutile, mais dont il est interdit « sous
peine d'arrestation », dit un écriteau catégorique,
de s'approcher et bien entendu de prendre des photographies.
Mais pour jouir de la vue unique peut-être au monde qu'on embrasse
de ce point privilégié, on se rend d'abord, en prenant à
droite sur la place du village, au cimetière européen, puis
on gagne le village indigène qui, avec ses koubbas ombragées
de palmiers nains et sa petite mosquée, est d'un aspect fort pittoresque.
De la Bouzaréa on aperçoit, au nord, les ravins abrupts
qui descendent vers la pointe Pescade, avec la mer et les navires qui
entrent ou sortent du port d'Alger ; à l'ouest, la pointe de Sidi-Ferruch,
les hauteurs du Sahel couronnées de villages, le tombeau de Juba
qui semble une énorme meule de foin, le Chenoua ; au Sud et à
l'Est, les hauteurs de Mustapha, le cap Matifou, l'Atlas où on
distingue la coupure de la Chiffa, les cimes neigeuses du Djurdjura.
C'est dans ce site enchanteur, à 1,800 mètres du village,
qu'a été érigé l'Observatoire d'Alger.
La situation de l'établissement est excellente. Les découvertes
qu'on y a faites et qui ont été
relatées en leur temps, font autant d'honneur à la vigilance
et à l'habileté du personnel qu'elles prouvent l'excellence
du choix de cette croupe du Sahel pour l'édification des diverses
coupoles destinées aux observations.
Nous avons pu récemment, grâce à la bienveillance
de M. Gonnessiat, parcourir en détail l'Observatoire d'Alger et
prendre les vues ci-contre qui, nous en sommes persuadés, intéresseront
nos lecteurs.
Au cours de la visite que nous avons faite, M. Gonnessiat nous a donné
les plus intéressantes indications sur le fonctionnement de l'établissement
dont il a la charge. Voici un résumé succinct des travaux
effectués en 1921.
Le cadre du personnel scientifique est toujours incomplet et ne comprend,
outre le directeur, qu'un astronome-adjoint, un aide astronome et deux
chargés des fonctions d'aide-astronome, de nationalité russe,
qui reçoivent ici l'hospitalité à titre provisoire.
Deux emplois d'astronome-adjoint sont vacants.
Le personnel auxiliaire comprend deux stagiaires et deux auxiliaires temporaires.
A l'instrument méridien, le directeur a continué les déterminations
précises du temps, soit dans le but de contrôler les signaux
horaires lancés par la Tour Eiffel, soit dans celui de rechercher
les erreurs systématiques qui peuvent entacher les catalogues fondamentaux,
ou celles qu'une réfraction latérale pourrait introduire
dans les observations du matin comparativement à celles du soir.
Le moment approche où l'on connaîtra l'heure au centième
de seconde près et où l'on pourra, grâce à
la radiotélégraphie, relier entre eux les principaux observatoires,
en connaître les positions à quelques mètres près,
et rechercher si ces positions varient par suite d'une torsion de l'écorce
terrestre.
La discussion des observations de distances zénithales faites à
Bouzaréa confirme le déplacement de l'axe de rotation de
la terre à l'intérieur du sphéroïde, et, par
suite, le balancement du pôle : la variation des latitudes peut
atteindre cinq à six dixièmes de seconde d'arc.
En 1921, les observations circumpolaires ont été reprises
dès septembre ; on y trouvera les éléments pour une
étude précise de la réfraction et pour une nouvelle
détermination de la latitude et de ses variations : toutes ces
recherches sont nécessaires pour donner au catalogue d'un millier
d'étoiles fondamentales en préparation toute la précision
nécessaire.
Le catalogue de la zone australe, contenant 10 000 étoiles observées
au cercle méridien, est en bonne voie d'achèvement : la
guerre en a retardé la publication.
L'astronome-adjoint, M. Rénaux, chargé de l'équatorial
coudé, s'en est servi pour déterminer les positions des
petites planètes et de quatre des comètes visibles, apportant
à ses mesures un grand soin et une remarquable habileté.
Comme calculateur, il a fourni un travail considérable, en calculant,
au cours de cette seule année, par des méthodes qu'il a
su perfectionner, une dizaine d'orbites de petites planètes, dont
les éléments étaient devenus très incertains.
L'équatorial photographique a été surtout utilisé
pour la recherche des petites planètes, principalement par le directeur
et un aide-astronome, M. Jekhowsky. On a obtenu 503 positions de 205 planètes
distinctes, parmi lesquelles s'en rencontre une nouvelle, la sixième,
que l'on découvre ici. Ces positions sont obtenues par référence
à cinq étoiles de repère et ont exigé une
somme considérable de travail tant de la part du personnel scientifique
que du personnel auxiliaire.
Pour la carte, l'héliograveur a pu tirer douze planches. Pour 27
clichés, les cuivres sont prêts: on espère les tirer
au cours de 1922. Les trois zones de chacune 2° de largeur, dévolues
à Alger, sont donc bien près d'être terminées.
Le septième volume du catalogue s'est augmenté de 18 feuilles
; il ne manque que cinq à six feuilles pour en terminer l'impression.
Les observations météorologiques complètes, avec
relevé trihoraire des diagrammes enregistreurs, ont été
continuées avec le même soin.
L'électromètre enregistreur du potentiel atmosphérique
a fonctionné sans interruption. Des résultats intéressants
ont déjà été tirés des huit années
d'observations que nous possédons. L'Office National a demandé
communication de nos courbes, pour les confronter soit avec celles obtenues
en d'autres stations, soit avec les divers caractères de la situation
générale de l'atmosphère. Cette étude intéresse
au plus haut point les transmissions radiotélégraphiques.
Le sismographe a fonctionné aussi sans lacune. Le dépouillement
des sismogrammes fournit chaque mois un bulletin échangé
avec celui d'une dizaine de stations françaises ou étrangères.
Les séismes les plus importants sont, signalés télégraphiquement
avec leurs caractères au bureau central sismologique de Strasbourg.
Enfin, on a mesuré les trois composantes du magnétisme terrestre.
On le voit : si les imposantes coupoles semblent dormir parmi le recueillement
de leur ceinture de pins et de cèdres, dans un calme qui convie
à la méditation et au repos, il n'en est rien et il règne
là une activité de tous les instants qui ignore la régularité
des heures, qui ignore la nuit et le jour.
M. Gonnessiat, qui est l'âme de l'Observatoire d'Alger et qui, avec
une amabilité charmante, a tenu à nous montrer le fonctionnement
de chaque appareil et a permis à un de nos collaborateurs de suivre
quelques instants une étoile fugitive à la lunette méridienne,
nous remet, en outre, à l'intention des lecteurs de l’Afrique
du Nord Illustrée, toute une série de beaux clichés
dont nous publions les plus intéressants.
Nous quittons l'aimable savant, enchantés des instants si agréables
que nous avons passés, en sa compagnie, dans son magnifique établissement,
Ce qui confère à l'astronomie l'attrait indiscutable qu'elle
exerce sur tous les esprits élevés, c'est précisément
qu'elle parait contenir son but en soi et qu'elle n'est appelée
à donner aucun résultat pratique. Elle est désintéressée,
elle est pure de toute contingence, de toute tendance mercantile.
Cette science est et ne saurait être que la science d'une élite.
Ils sont à plaindre ceux qui n'en peuvent saisir l'incomparable
valeur au point de vue intellectuel. Laplace a dit d'elle :
« ... L'astronomie, par la dignité de son objet et la perfection
de ces théories, est le plus beau monument de l'esprit humain,
le titre le plus noble de son intelligence. Séduit par les illusions
des sens et de l'amour-propre, l'homme s'est regardé longtemps
comme le centre du mouvement des astres et son vain orgueil a été
puni par les frayeurs qu'il lui ont inspirées. Enfin, plusieurs
siècles de travaux ont fait tomber le voile qui lui cachait le
système du monde. Alors, il s'est vu sur une planète presque
imperceptible dans le système solaire dont la voûte étendue
n'est elle-même qu'un point insensible dans l'immensité de
l'espace. Les résultats sublimes auxquels cette découverte
l'a conduit sont bien propres à le consoler du rang qu'elle assigne
à la terre, en lui montrant son extrême grandeur dans la
petitesse de la base qui lui a servi pour mesurer les cieux. Conservons
avec soin, augmentons le dépôt de ces hautes connaissances,
les délices des êtres pensants. Elles ont rendu d'importants
services à la géographie et à la navigation ; mais
leur plus grand bienfait est d'avoir dissipé les craintes produites
par les phénomènes célestes et détruit l'ignorance
de nos vrais rapports avec la nature, - erreurs et craintes qui renaîtraient
promptement si le flambeau, des sciences venait à s'éteindre...
».
Et les pâtres chaldéens qui, dans le mystère enchanté
des nuits orientales, avaient surpris le rythme étincelant des
constellations, étaient moins arriérés que ceux qui,
de nos jours, s'étonnent qu'on sacrifie à une science aussi
merveilleuse.