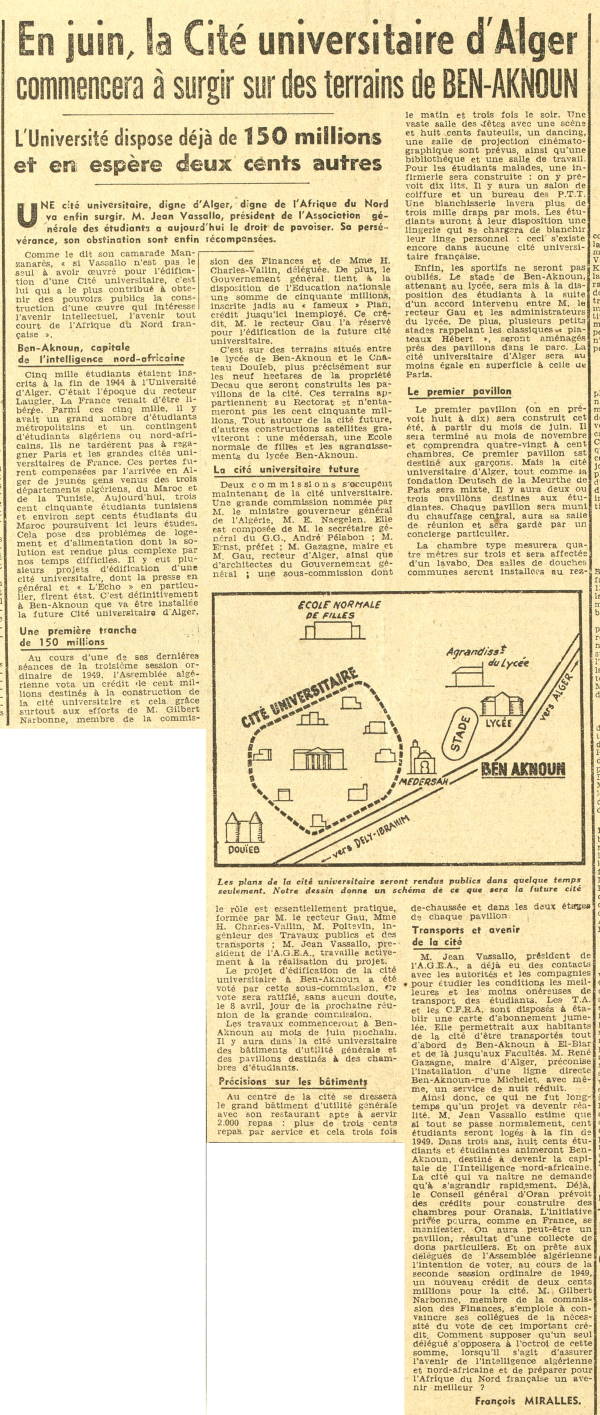
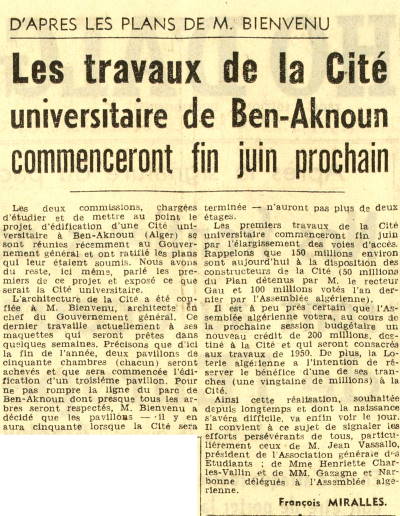
(Echo d'Alger des 31 mars et 4 mai 1949)


Un
grave problème: loger les étudiants
______________________________________________
LA CITE UNIVERSITAIRE D'ALGER
une des plus belles du monde
va s'élever à Ben-Aknoun
______________________________________________
LA CITE UNIVERSITAIRE D'ALGER
une des plus belles du monde
va s'élever à Ben-Aknoun
Deux
bâtiments en construction, des ouvriers, des grues, des camions,
des coups de marteau. "La France, nous dit M. Bienvenu, architecte
D.P.L.G., est la première nation du monde à créer
en dehors de son territoire métropolitain une cité universitaire..."
Nous sommes à Ben-Aknoun, en plein champ ; non loin de là,
à l’est, le lycée. C’est sur vingt-huit hectares
de ce plateau vallonné, tourné vers la Mitidja que se dresseront
au fur et àmesure les quelques 22 bâtiments qui formeront
la cité universitaire d'Alger. Mais que de temps, que de tâtonnements
et d’expédients ont été envisagés avant
d’en arriver à cette dernière solution, la seule qui
plaise vraiment aux étudiants !
Les étapes parcourues
1945. - Au lendemain de la guerre, le nombre d’étudiants
s’accroît sans cesse, les démobilisés rentrent,
les logements manquent, les services administratifs occupent encore la
plupart des locaux... Des étudiants couchent en gare d’Alger
dans des wagons désaffectés, d’autres vivent dans de
misérables réduits... : il n’y a pas de ponts à
Alger et, spectacle désolant, on utilise les squares pour une nuit
au moins ! Certains, découragés, abandonnent... Les cours
se succèdent... Pourtant on propose l’hôtel d’Angleterre
: son achat et sa réfection nécessitent l’engagement
d’une somme de 2 millions et demi de francs. Phénomène
inexplicable, M. Martino, alors recteur, refuse !...
1946. - Le Rectorat, le comité des Œuvres sociales
de l’Université d’Alger, l’Association générale
des Étudiants cherchent une solution. On parle d’un hôtel
rue Rovlgo mais le prix est excessif. L’école de la Marine
propose son foyer de la rue des Colons : une réfection s’impose.
La solution est peu avantageuse.
L’année passe, on cherche toujours... Pendant ce temps, certains
étudiants s’affublent du titre de clochard, contre leur gré
évidemment...
1947. - On songe à construire : des terrains sont disponibles
dans la ville même ; les pavillons seront isolés. On parle
de l’avenue Claude-Debussy, du Télemly, de l’église
Ste-Marcienne, du Champ de Manœuvres, de l’avenue du 8-Novembre...
Mais les étudiants pensent déjà à une cité,
comme celle de Paris, de Nancy ou de Bordeaux...
1948. - Un accord avec les hôteliers intervient ; des chambres
à prix réduit seront disponibles, mais le résultat
est décevant. le nombre de chambres trouvées infime. Jean
Vassallo. alors président de l’A.G., mène tenacement
la campagne. Il suggère qu'on lève la réquisition
des chambres qui demeurent inoccupées par leurs bénéficiaires,
pendant une bonne partie de l’année. . Ernst, préfet
d’Alger, entre en lice et lance un appel. Enfin un résultat
tangible : les offres arrivent, se multiplient. Un premier pas est fait.
Mais cela n'est pas suffisant...
1949. - On parle déjà d’une cité sur
la propriété du prince d’Annam. Pour aller vite, on
propose des maisons préfabriquées, mais les incendies de
la Cité universitaire de Strasbourg et de chalets en Savoie démontrent
trop l’inconvénient du "tout en bois". Et brusquement
c’est la solution idéale rêvée ! M. le recteur
Gau suggère un terrain qui appartient à l’Université
d’Alger, à Ben-Aknoun.
I1 faut passer aux actes... Cependant, le C.O.S.U.A.L. et l’A.G arrivent
au prix d’efforts sans nombre loger pour novembre 160 étudiants.
C’est peu, mais c‘est beaucoup si l'on jette un regard sur le
passé !
L'équipe des
réalisateurs
"Alger se doit d’avoir sa cité universitaire, car rien
n’est plus favorable au développement de la vie étudiante
sous toutes ses formes. Il faut taire vite". Telle était la
pensée d'un grand nombre d’étudiants et en particulier
de Jean Vassallo qui, dès novembre 1947, date à laquelle
il fut élu président de l’A.G., n’eut plus qu’un
but : réaliser cette idée qu’il allait poursuivre pendant
deux ans et qu'il continue aujourd’hui au sein du bureau du conseil
d’administration de la Cité qui vient d’être élu
sous la présidence de Mme Henriette Charles-Vallin. Est-il besoin
de rappeler que la vice-présidente de l’Assemblée algérienne
s’est toujours penchée avec compréhension sur les problèmes
étudiants et que son concours a été décisif
quand il s'est agi de convaincre les Pouvoirs publics et les ministres
intéressés. Il fallait un technicien et nul n'était
plus compétent que le grand architecte, disons mieux, le grand
urbaniste qu’est M. Bienvenu. Il fallait des crédits, il fallait
un terrain.Avec l’aide et l’appui le plus ferme de M. le recteur
Gau, tous ensemble, ils ont su les obtenir avec une volonté qui
doit être un exemple.Ces noms resteront attaches à l’histoire
de cette cité ; mais on oubliera très vite les difficultés
auxquelles il aura fallu faire face ! Et l’étudiant, si heureux
dans ce cadre, ne s’en rendra même plus compte ! Qu’importe,
la cité aura été créée et ses artisans
auront triomphé : ce sera leur plus belle récompense.
Aspect général
M. Bienvenu, M. l’administrateur de la S.A.L.D.E.C.O., société
adjudicatrice des deux premiers pavillons, et M. Vassalio nous exposent
ce que sera la cité. Une voie d’accès, large de 10
à 12 mètres quittera la route départementale et mènera
à un rond-point, véritable carrefour de la cité.
De cette voie et de ce rond-point, d’autres routes rayonneront vers
les différents bâtiments. Dix-huit pavillons hébergeront
les étudiants :
trois d’entre eux, situés sur une petite colline et légèrement
isolés des autres, abriteront les jeunes filles.
Une jolie villa mauresque, anciennement habitée par le recteur, entourée d‘arbres et de fleurs, logera le directeur et les services administratifs.
Un immense bâtiment, dans lequel des chambres et des dortoirs seront
réservés aux professeurs et étudiants de passage,
formera la bibliothèque et les salles de travail.
Un grand stade,

Pavillon Jean Vassallo et terrains
de sports
des parcs à auto, un salon de coiffure, des jardins,
une multitude de terrains de jeux divers et variés contribueront
à donner à la cité un aspect d‘autonomie à
peu près complète, un aspect de petite ville !
Rappelons, devant cet immense projet en voie de réalisation, que
la Cité universitaire de Paris ne couvre pas 10 hectares ! M. Bienvenu
a voulu faire de celle d’Alger un modèle, un exemple... On
a vu grand, on a vu large. Mais notre étonnement est plus grand
encore lorsque l’on nous parle des pavillons eux-mêmes.
Les pavillons
Tous les pavillons seront en arc de cercle, dirigés suivant la
meilleure orientation possible : Nord-Est-Sud-Est. . Ils comprendront
un rez-de-chaussée et deux étages et logeront chacun une
cinquantaine d'étudiants, à raison de un par chambre. Au-dessus
de la porte d’entrée principale, des bas-reliefs. tracés
par le sculpteur Damboise contribueront à en faire une œuvre
d’art. Cette entrée donnera sur un vestibule richement décoré,
au fond duquel des escaliers mèneront aux étages supérieurs.
Chaque pavillon aura son concierge, qui logera au rez-de-chaussée.
Toutes les chambres seront d’un même coté du couloir,
ce dernier étant exposé au Nord-Ouest, c'est-a-dire au mauvais
temps, point qui a été difficile à obtenir, mais
le souci de l’hygiène a finalement triomphé. Au rez-de-chaussée,
sur les façades Nord-Ouest, de chaque coté de la loge du
concierge, deux préaux... En outre, chaque étage aura des
locaux communs, une cuisine, une lingerie, des salles de bains, etc...
Tout autour du pavillon, des fleurs, des arbres, des terrains de jeux.
Les chambres
Toutes les chambres seront exposées au soleil levant. Mais si M.
Bienvenu a été guidé par le souci de l’hygiène,
il l’a été aussi par celui du confort et du bien-être.
Chaque chambre aura environ 3 m. 50 sur 4 et possédera en propre
un cabinet de toilette avec eau chaude courante et douche. Tout a été
prévu : l’emplacement du poste de T.S.F., le placard, penderie,
garde-manger, porte valise, le garde-chaussures, etc... Au dos de la porte
du cabinet de toilette, l’étudiant disposera d’un tableau
noir ! Le souci du progrès a été poussé si
loin qu’il y aura même une prise de courant dans le cabinet
de toilette pour les amateurs du rasoir électrique ! Les chambres
du rez-de-chaussée donneront toutes sur un parc, par une large
porte-fenêtre devant laquelle un petit parvis permettra à
l‘étudiant, « ce travailleur intellectuel »,
de s’assoupir un instant au soleil... Celles du premier étage
seront un peu en retrait et donneront de la même façon sur
une petite terrasse, tandis que celles du second, en retrait aussi, seront
bordées par un large balcon ; autrement dit, il y aura du soleil
pour tous dans la maison ! D’autre part, les bâtiments seront
insonorisés et les cabinets de toilette s’intercaleront entre
chaque chambre, ce qui permettra de se livrer à de puissantes vocalises
sans déranger le voisin. Le chauffage s'effectuera par circulation
d’eau chaude. Toutes les conduites d’eau et d'électricité
seront extérieures aux chambres, de façon qu’aucune
réparation n’occasionne un dérangement quelconque au
pensionnaire. Quant à la question de l’évacuation de
l’eau, elle fait actuellement l’objet d’une étude
particulière.
Impression d’ensemble
Nous ne saurions décrire ici tout le luxe de petits détails
qui permettront à l’étudiant de travailler dans les
meilleures conditions voulues. Nous avons l’impression qu’ils
sont l’œuvre d'un père pour ses enfants ; à chaque
pas, à chaque coin, nous rencontrons une surprise, une particularité...
Et lorsqu’on jette un regard d’ensemble sur toute cette conception,
on se sent en face d’un chef-d’œuvre naissant en face de
ce qui sera une merveille de l’art architectural moderne où
le talent de l’architecte a su jouer artistement avec la ligne horizontale.
Mais il est encore une question délicate à laquelle les
réalisateurs ont déjà pensé : c’est celle
du fonctionnement administratif de la cité, question que Mme Charles-Vallin
et M. J. Vassallo étudient et complètent chaque jour.
Comment fonctionnera
la Cité universitaire
Cette cité ne sera pas, comme ses sœurs métropolitaines,
un service public, mais une association privée qui devra se suffire
à elle-même. Ainsi ce sera une charge de moins sur le budget
de l’État qui aura permis son édification. Les ressources
de cette association proviendront du prix de pension, qu’on essayera
de rendre le plus bas possible, et qui sera à peu près identique
aux prix pratiqués dans les lycées et collèges. De
toute façon, le prix de la chambre, des repas, de l’entretien
et du transport de l’étudiant sera de beaucoup inférieur
à ce que coûte la pension actuelle en pleine ville ! Le personnel
de la cité, au nombre d’une centaine. sera logé sur
place. Le restaurant servira chaque jour 1.000 à 1.500 repas.
LES TRANSPORTS. — Le seul inconvénient serait celui
de l’éloignement. Mais la question des transports se résout
déjà. : des pourparlers sont en cours pour avoir un abonnement
unique sur les trams et trolleys T.A. et C.F.R.A. réunis. Peut-être
arrivera-t-on à avoir une ligne directe Cité-Facultés,
(note
du site : ce sera fait en 1956 avec la création de la ligne 7 barré
des CFRA Ben-Aknoun - Plateau des Glières)
peut-être encore, ce qui est mieux, la cité aura son service
autonome ! Faisons confiance aux organisateurs, à l'équipe
de réalisateurs, qui a déjà surmonté l’insurmontable
!...
Les réalisations
actuelles
Les crédits
L’action de Mme Charles-Vallin, le soutien du cabinet de M. le Gouverneur
général, la compréhension unanime des délégués
à l’Assemblée algérienne ont permis à
la cité de « démarrer » au plus vite.
Une première tranche de 100 millions avait déjà été
votée l’hiver dernier. C’est à la S.A.L.D.E.C.O.
qu’a été dévolue la charge de construire les
deux premiers pavillons. Fin mars, ces pavillons seront terminés
et prêts à recevoir une centaine d’étudiants.
Mais le travail se poursuit : déjà Mme Charles-Vallin a
déposé, sur le bureau de l’Assemblée algérienne,
une motion demandant d’utiliser les crédits avant qu’ils
ne soient votés, car ils ne sauraient l’être avant avril
ou mai. Grâce à cette motion, M. Bienvenu a préparé
le plan de deux autres pavillons qui vont être mis en adjudication
à la fin de ce mois. En novembre 1950 donc, on peut espérer
pouvoir loger un maximum d’étudiants en attendant mieux.
Conclusion
Il resterait encore beaucoup à dire sur les étapes qui ont
mené jusqu’à la réalisation de notre cité
universitaire, sur le travail qu’elle a demandé à Mme
Charles-Vallin, à M. Bienvenu, à M. le recteur Gau, à
Jean Vassallo... Un de leurs plus grands mérites est d’avoir
toujours sollicité l’avis des étudiants eux-mêmes,
par la voix de leurs différentes associations, jusque sur le choix
du terrain... Leur rôle est resté trop obscur, certains même
le nient et pourtant. Pourtant, la cité n’est plus le rêve
qu’Alger nourrissait depuis 20 ans, elle est déjà une
réalité. Que les sceptiques s’y attardent, au hasard
d’une promenade, et ils verront les échafaudages qui se dressent
vers le ciel. Une seule réalisation de ce genre peut être
signalée : c’est celle du lac Kivou, an Congo beige, mais
là c’est une cité-refuge pour tous les savants qui
voudront y trouver asile, après la destruction de l’humanité
! Alors que la cité universitaire d’Alger est un geste de
pure confiance en l’avenir... car il y a toujours en France de la
place et de l’espoir pour les hommes de demain !


